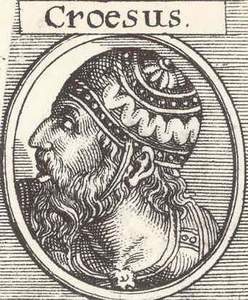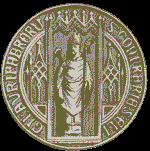|
Les premières formes de monnaie
|
1, Une monnaie-marchandise
Selon la civilisation considérée la monnaie a pris différentes formes telles que des coquillages (Inde), des défenses d'éléphants, des perles, des dents d'animaux (cachalot aux Iles Fidji), des pierres rares, des peaux, des fourrures, des tuiles en thé séché (Mongolie, Chine), du sel (Ethiopie), du tabac (Virginie), de la morue sèche (Terre-Neuve) ou du blé (Egypte). Ces objets constituent ce que nous appellons des monnaies primitives ou paléo-monnaies. Ces monnaies sont très nombreuses et limitées car utilisées comme moyen d'échange à échelle locale. En effet, l'Homme antique utilise comme unité monétaire l'objet qu'il crée de ses mains : fer de hache, des couteaux, des lingots de métal, des bijoux... Ainsi, des disques immenses de pierres trouées étaient utilisés comme monnaie dans les Iles Carolines, des colliers en argent en Thaïlande, des haches (Bretagne), des manilles (anneaux d'esclave) en Afrique …
Soulignons aussi la première monnaie considérée comme monnaie internationale : les cauris. Ces coquillages originaires des Maldives furent utilisés en Asie du Sud-est (Philippines, Vietnam, Inde Chine) et surtout en Afrique de l'Ouest (Congo, Cameroun, Togo, Senegal…) jusqu'au Xxème siècle. Ils servaient d'instrument d'échange et permettait l'épargne. Les cauris étaient souvent percés et groupés en tas pour faciliter le comptage dans les transactions commerciales. C'est ainsi que la monnaie est devenue chez tous les peuples civilisés l'instrument universel du commerce, et que les marchandises se vendent et s'achètent ou bien s'échangent l'une contre l'autre.
   |
2, Une monnaie métallique
Les monnaies métalliques sont apparues en même temps que les premières forges. La monnaie devient alors un instrument d'échange précieux et de grande valeur puisque frappée en or ou en argent. Les monarques de l'époque y voyant la possibilité d'un contrôle monopolisent sa frappe. Au VIIème av-Jc siècle apparaissent en Chine, les premières monnaies officielles métalliques. En Occident, la monnaie métallique apparaît vers le milieu du VII ème siècle av- JC chez les Grecs d'Asie Mineure (côte occidentale de la Turquie). Les premières monnaies émises sont globulaires (forme de goutte) et frappées dans un alliage naturel d'or et d'argent : l'électrum. Cet électrum provient du Pactole, petite rivière qui s'écoule en Lydie (ancien pays d'Asie Mineure) et charrie des pépites d'un mélange d'or et d'argent. D'ailleurs cette rivière a donné naissance à l'expression " toucher le pactole ".

D'autre part, de petits lingots d'électrum sont coulés, de poids constant, de même forme et portant une effigie symbolique propre à la cité qui les ont émis. Ainsi à partir de 575 av-Jc, on voit circuler des pièces avec l'emblème de la chouette (référence à Athéna déesse protectrice de la cité athénienne), celui de Pégase (le cheval ailé pour Corinthe)…Ces effigies d'ordre réels ou légendaires garantissaient la valeur de la monnaie : le poids et l'aloi c'est à dire les quantités de métal précieux introduites dans l'alliage ainsi que les proportions. Elles symbolisaient également l'emprise du pouvoir politique sur la création et la régulation de sa production.
  |
3, La monnaie grecque
Vers 510 av-Jc, le roi de Lydie, Crésus, introduit le premier un monnayage bimétallique, d'or et d'argent purs, en remplacement des monnaies d'electrum. Son système dit système bimétalliste s'appuyait sur les progrès de la métallurgie, devenue capable de séparer l'or de l'argent contenu par les pépites d'électrum. Ses premières monnaies nommées les créséides sont frappées en or et explique la richesse mythique de Crésus : l'or est rare donc représente une valeur assez conséquente et les pièces de monnaie concentrent cette valeur dans une masse réduite. Le coin-matrice est mis au point à cette époque : il permet d'obtenir des empruntes (effigies ou syboles) en relief sur les faces de la pièce. Vers 450 avant J-C, les Grecs réussirent à imposer le tétradrachme d'argent sur tout le bassin méditerranéen y compris en dehors de leur zone d'influence (Espagne, Gaule …).
   
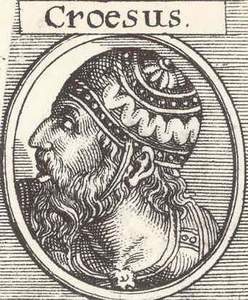
C'est ainsi qu'à partir de l'Asie Mineure se diffusa l'emploi de la monnaie dite métallique dans tout le bassin méditerranéen. Notons les pièces macédoniennes qui se répandirent avec les conquêtes des rois de Macédoine, le célèbre Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre Le Grand qui impose sa monnaie, un statère d'or pour vingt drachmes d'argent à tous ses territoires conquis. Un siècle après son invention, la monnaie est courante dans le monde grec. La frappe de la monnaie se poursuit avec de l'or et de l'argent, puis le cuivre et le bronze se généralisent dès la conquête romaine. Le Drachme et l'obole (qui vaut 1/6e de drachme) sont les monnaies principales qui constituent le système monétaire grec.
   |
4, Les monnaies romaines et les monnaies barbares
L'empire romain à cette même époque applique la loi des douze tables qui annonce la naissance d'une nouvelle monnaie remplaçant la tête de bétail : des lingots fabriqués dans un alliage d'étain, de cuivre et de plomb ornés d'un bœuf appelés as. Les dimensions, les poids et les valeurs des monnaies en cours sont ensuite uniformisés. Progressivement, de nombreuses pièces romaines ont été introduites avec le développement de l'Empire, toutes frappées dans le temple du Juno Moneta (qualifiée d'avertisseuse), au Capitole. Nous distinguons le denier d'argent (pièce de dix en 211 avant J.C.), l'aureus d'or (14 après J.C.), l'antoninianus (214 après J.C.), le follis (295 après J.C). Notons aussi le solidus ou sou d'or (315 après J.C). Le sou d'or sera mis par Constantin en circulation pour relancer l'économie romaine en pleine décadence et réorganiser l'Empire. Après la dislocation de l'Empire romain, l'usage de cette monnaie se perpétuera encore longtemps à Byzance. Les pièces frappées sous l'Empire seront également des instruments de propagande à la gloire de l'empereur et de ses victoires militaires.
A partir du milieu du Ier siècle av. J.-C, la Gaule est sous domination romaine. Ainsi, les Gaulois vont progressivement adopter le système monétaire de l'Empire, c'est à dire le denier et le sesterce, monnaies les plus employées à l'époque. Celles-ci sont employées dans les échanges commerciaux mais également pour le paiement des impôts.
En 476 ap-jc, les barbares envahissent et occupent l'Empire romain d'occident. Au VIe siècle, le peuple franc commence à s'imposer économiquement par rapport aux autres peuples. Cette suprématie est synonyme de diffusion d'une identité franque qui se réalise grâce aux pièces de monnaie qui présentent des légendes relatives à la culture franque. Par exemple, le nom du roi actuel de la dynastie mérovingienne (à partir de Théodebert Ier, 534-548), celui de l'autorité religieuse locale ou bien le personnage responsable de la frappe monétaire (Elagius pour Saint Eloi) sont présents sur les faces des pièces.
 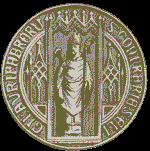
|
5, Les monnnaies du Moyen-Age
Au Moyen-Age, la circulation monétaire est encore assez faible et le troc encore très utilisé. La frappe de la monnaie n'est pas encore centralisée, des petits ateliers présents sur tout le territoire contrôlent la frappe des pièces dirigée sous la tutelle de l'autorité locale. Pour obtenir cette certaine forme de pouvoir que constitue la frappe de la monnaie, Pépin le Bref (751-768) décide la fermeture des ateliers, du poids et du titre des émissions ainsi que les symboles apparaissant sur les pièces.
Poursuivant les réformes de son père, Charlemagne (768-814), abandonne le système monétaire reposant sur le sou d'or pour unifier son royaume et faciliter les échanges. Il démonétise les anciennes monnaies et instaure un nouvel étalon emprunté aux mesures de poids, la livre de 322,2 g valant soit 240 deniers, l'unité de base restant le denier. Le seul métal précieux dont les francs disposent en abondance est l'argent : le denier est ainsi frappé en argent. Ce denier est gravé (portrait de Charlemagne et la croix qui affirme l'origine divine du pouvoir impérial.

Au Xème siècle, les rois carolingiens n'ont plus les moyens de s'imposer politiquement et économiquement. Ainsi, des vassaux puissants tels que des comtes, des évêques frappent leur propre monnaie, dont le poids varie suivant la région où elle est émise. Par exemple, le digne instigateur de la dynastie des Capétiens, Hugues Capet (987-996), est entouré de puissants personnages battant monnaie à leur nom : des deniers beauvaisis, guingampois... circulent avec les deniers émis par le pouvoir royal. Ceci pose un problème complexe pour les échanges.
Aux XIeme et XIIeme siècles, l'économie est en plein essor. La croissance de la population urbaine est la conséquence de ce phénomène : de nombreux artisans (tisserands, menuisiers, orfèvres…) et commerçants affluent en ville pour réaliser des affaires. De nombreuses foires sont organisées et le besoin d'argent sous forme de monnaie métallique s'accroît. Philippe-Auguste prend le pouvoir en 1180 (jusqu'en 1223).
A partir de cette date, la monarchie capétienne ne cessera d'étendre son autorité politique et économique sur le territoire. Le souverain utilise la monnaie comme instrument d'unification du royaume en interdisant et supprimant dès 1204 le denier angevin qu'il remplace par le denier tournois, frappé en son nom en l'abbaye Saint Martin de Tours. Le denier tournois sera la première monnaie qui s'imposera dans le nord du royaume (après la victoire de Bouvines 1215 sur le comte de Flandre).
Sous le règne de Louis IX (1226-1270), le commerce international prend de l'envergure.
Pour pallier la faiblesse du denier, le roi décide alors de frapper : le sou tournois en argent, qui a une forte valeur et correspond à 12 deniers. Cette pièce désignée comme le gros tournoi est la première matérialisation du sou dans l'histoire monétaire française. Afin de limiter les crises monétaires du royaume, Philippe IV le Bel (1285-1314) crée le double tournois, dont la valeur en argent ne représente qu'une fois et demie celle du denier. Seule l'inscription de la valeur apparaît, c'est donc de là que la fiduciarité des monnaies trouve son origine : la valeur d'une pièce n'est plus déterminée par son poids de métal précieux, mais par la confiance du public dans l'Etat.
 
Durant la Guerre de Cent Ans la France éprouve de grandes difficultés économiques. C'est ainsi qu'apparaît le franc en 1360. Il s'agit d'une pièce d'or valant une livre tournois et représentant Jean II le Bon (1350-1364) armé, à cheval. Le roi, qui avait été fait prisonnier par les Anglais en 1356 est "franc des anglais", c'est-à-dire libre. Le franc émis est dit " franc à cheval ". A la fin de la Guerre de Cent Ans le commerce européen reprend vigueur. Jacques Coeur (1395-1456), grand argentier du roi Charles VII (1422-1461), redresse le système monétaire. Il procède à un rééquilibrage des monnaies par rapport à la valeur de l'or et de l'argent et crée en 1436 l'écu d'or à la couronne. Pour sa part, Louis XI (1436-1483) instaure l'écu d'or au soleil, symbole du rayonnement de la royauté. |